Ray Bradbury – Fahrenheit 451, ou le pompier et l’Ecclésiaste. Généalogie d'un possible...
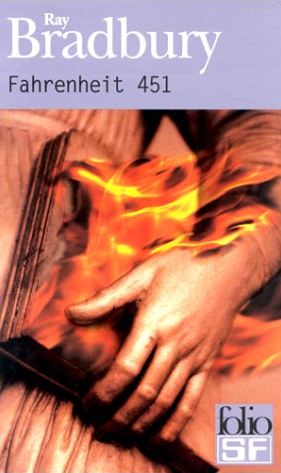 Imaginez un monde ou les pompiers seraient chargés non pas d’éteindre les incendies mais de jouir du privilège de brûler
le moindre livre – et accessoirement la maison de son propriétaire, occupants y compris si nécessaire. Un monde de divertissement forcené et de paillettes noyé dans un vacarme assourdissant. Un
monde de familles factices sur fonds d’écrans, plantés dans le salon de populations sous perfusion médicale. Un monde plongé dans un éternel présent, ayant bu jusqu’à la lie la coupe du fantasme
de la Fin de l’Histoire. Un monde sans racines, vouant un culte abrutissant à la vitesse. Un monde scintillant sur fond de guerre - un ectoplasme de guerre présenté comme une formalité
insignifiante, indolore ; un problème à régler en quelques bombes, avec pour finalité la destruction massive d’un ennemi sans moindre consistance…
Imaginez un monde ou les pompiers seraient chargés non pas d’éteindre les incendies mais de jouir du privilège de brûler
le moindre livre – et accessoirement la maison de son propriétaire, occupants y compris si nécessaire. Un monde de divertissement forcené et de paillettes noyé dans un vacarme assourdissant. Un
monde de familles factices sur fonds d’écrans, plantés dans le salon de populations sous perfusion médicale. Un monde plongé dans un éternel présent, ayant bu jusqu’à la lie la coupe du fantasme
de la Fin de l’Histoire. Un monde sans racines, vouant un culte abrutissant à la vitesse. Un monde scintillant sur fond de guerre - un ectoplasme de guerre présenté comme une formalité
insignifiante, indolore ; un problème à régler en quelques bombes, avec pour finalité la destruction massive d’un ennemi sans moindre consistance…
Un monde enfin où, contrairement à l’univers de 1984 d’Orwell, il n’existe aucun totalitarisme tombé d’en haut, aucun Big
Brother, mais juste un nivellement festif consenti par les masses pour la propre tranquillité de chacun ; de chaque communauté, chaque minorité, chaque individu. Un « Empire du moindre mal »,
pour reprendre le titre de l’essai magistral sur la civilisation libérale de Jean-Claude Michéa, où le libéralisme culturel, associé au consumérisme, son pendant économique, est parvenu à
sa pleine maturité, à son propre terme, avec pour évidence naturelle la neutralisation de toutes les libertés - et en particulier celle de lire -, vécues comme atteinte insupportable à
l’écoulement mou d’une existence imbibée de confettis et de pilules euphorisantes.
Voici le décor planté du roman (1) culte de l’écrivain américain Ray Bradbury, dont le titre fait référence au
point d'auto-inflammation, en degrés Fahrenheit, du papier (233°C).
(A ceux n’ayant pas lu le livre et qui souhaitent conserver toute la fraicheur de l’intrigue, je conseille de
passer les passages colorisées en noir dans ce qui suit)
.
Côté des acteurs, en quelques mots, au centre de l’intrigue se
trouve la conscience ignifugée du pompier Montag. Elle se délite. Le grain de sable ayant grippé sa routine mentale se prénomme Clarisse, une voisine, étudiante de son état, rencontrée
une nuit dans la rue par l’effet d’un pseudo - hasard, alors qu’il rentre d’une expédition, achevée comme il se doit par un feu de joie. Contrairement à d’autres elle ne craint pas les
pompiers. « Bien sûr que je suis heureux », s’emportera-t-il ce soir-là à l’une question de l’impertinente.
A la maison l’attend son épouse Mildred, une femme vidée de
toute substance, avec laquelle il cohabite par force d’habitude. Ils ne souviennent même pas quand ils se sont rencontrés. Il y a aussi les amies de sa femme, « la famille », étalée sur les
murs et la caserne, gardée par un limier robot, espèce de molosse mécanique chargé de traquer et intercepter (voire tuer), les possesseurs de livres.
Le chef de Montag, qui s’appelle Beatty, finira en brasier de la Saint-Jean sans que l’on sache s’il avait des tendances suicidaires. En attendant c’est un vieux de la
veille qui connait la musique. Les pompiers y passent tous un jour à l’autre, lâche-t-il un matin à Montag rongé par le doute quant au bien-fondé de son métier. C’est que pour la première fois de sa carrière, le pyromane joyeux s’est en effet porté malade après avoir appris la disparition de Clarisse. Cloitré chez lui, forçant Mildred
horrifiée à l’écouter, il s’est mis à lire des livres volés lors de ses missions, reliques arrachés au feu sans trop savoir pourquoi.
Il se souvient alors d’un vieil homme
rencontré dans un parc, Faber, un professeur d’anglais à la retraite ; un lecteur qu’il n’a jamais dénoncé.
Ecoutons-le :
« Nous ne naissons pas libres et égaux, comme le proclame la Constitution,
on nous rend égaux. Chaque homme doit être l’image de l’autre, comme ça tout le monde est content ; plus de montagnes pour les intimider, leur donner un point de comparaison. Conclusion
Un livre est un fusil chargé dans la maison d’à côté. Brûlons-le. Déchargeons l’arme.
(…)
Les gens veulent être heureux, d’accord ? N’avez-vous pas
entendu cette chanson dans toute votre vie ? Je veux être heureux disent les gens. Eh bien, ne le sont-ils pas ? Ne veillons-nous pas à ce qu’ils soient toujours en mouvement, à ce qu’ils aient
des distractions ? Nous ne vivons que pour ça non ? Pour le plaisir, l’excitation ? Et vous devez admettre que notre culture nous fournit tout ça à, foison ».
Et de poursuivre :
« Les Noirs n’aiment pas Little Black Sambo. Brûlons-le.
La Case de l’oncle Tom met les blancs mal à l’aise. Brûlons-le. Quelqu’un a écrit un livre sur le tabac et le cancer des poumons ? Les fumeurs pleurnichent ? Brûlons le livre. La sérénité
Montag. A la porte, les querelles. Ou mieux dans l’incinérateur ».
La méthode est simple pourtant : endormir le chaland sous
l’avalanche de l’information et refuser la philosophie :
« Bourrez les gens de données incombustibles, gorgez-les
de ‘faits’, qu’ils se sentent gavés, mais absolument ‘brillants’ côté information. Ils auront alors l’impression de penser, ils auront le sentiment du mouvement tout en faisant du surplace. Et
ils seront heureux parce que de tels faits ne changent pas. Ne les engagez pas sur des terrains glissants comme la philosophie ou la sociologie pour relier les choses entre elles. C’est la
porte ouverte de la mélancolie. »
La mélancolie est donc proscrite.
Mais Montag n’aura pas le temps de s’y
appesantir car il vient d’être dénoncé et doit brûler sa propre maison, tout se considérant en état d’arrestation.
.
Il ne serait pas séant de conter la suite de l’histoire, sans
nuire gravement au plaisir de lecture de qui voudrait se plonger dans Fahrenheit 451.
Aussi, tout ce que je m’autoriserai à dire encore, c’est que
dans ce monde en carton-pâte, l’amour de la lecture n’est pas tout à fait éteint. Certains ont en effet jamais pu se résoudre à l’oubli et tentent encore de résister à la déferlante festive.
Là, au-delà de la cité, alors que les bombardiers se mettent en branle, le long du fleuve dans la forêt, autour d’un grand feu se joue peut-être le destin d’une humanité à l’agonie. Certes la
résistance dérisoire et incertaine. Mais n’en va-t-il pas toujours ainsi ?
L’arrière-garde est vieillissante. Il lui faut du
neuf.
Le monde est pourtant ouvert encore sur tous les
possibles.
« Je tiens à vous présenter Jonathan Swift, l’auteur de
cet ouvrage politique si néfaste, Les voyages de Gulliver ! Et cet autre est Charles Darwin, et celui-ci Schopenhauer… »
Il ne manquait que l’Ecclésiaste !
(1) Les spécialistes et les pédants parleront ici de roman dystopique : « Une dystopie, également appelée
contre-utopie, est un récit de fiction peignant une société imaginaire organisée de telle façon qu'elle empêche ses membres d'atteindre le bonheur, certains disent aussi que c'est une utopie qui
vire au cauchemar et conduit donc à une contre-utopie ». (Source Wikipédia)




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire