Lorsqu’on évoque le nom d’Alexis de Tocqueville on songe immédiatement à ‘De la démocratie en Amérique’. Mais ce n’est pas au penseur libéral qui craignait ‘la tyrannie de la majorité’ auquel j’entends vouer ces lignes, mais à l’aventurier épris de grands espaces ; à cet homme d’alors 26 ans, à la quête d’une expérience de vie au cœur de la nature intacte ; ces déserts végétaux d’Amérique que n’ont pas encore mangés la civilisation et le progrès.
C’est dans le cadre d’une mission aux Etats-Unis, pour y étudier le système pénitentiaire que Tocqueville échafaudera cette équipée qui de Détroit, passant par Pontiac, le conduira jusqu’au petit village de Saginaw, lové au creux d’« une petite plaine cultivée, bordée au sud par une belle et tranquille rivière ; à l’est, à l’ouest et au nord, par la forêt ». Au réveil, près des voyageurs « s’élevait une maison dont la structure annonçait l’aisance du propriétaire. (…) Une maison de même espèce s’apercevait à l’autre extrémité du défrichement. Dans l’intervalle et le long de la lisière du bois, deux ou trois log houses se perdaient à moitié dans le feuillage. Sur la rive opposée du fleuve s’étendait la prairie comme un océan sans bornes dans un jour calme. Une colonne de fumée s’en échappait alors et montait paisiblement dans le ciel. En ramenant l’œil au point d’où elle venait, on découvrait enfin deux ou trois Wigwams, dont la forme conique et le sommet aigu se confondait avec les herbes de la prairie ». Voilà à quoi ressemblait alors cet avant-poste de la civilisation, « dernier point habité par les européens, au nord-ouest de la vaste presqu’île de Michigan, (…) sorte de guérite que les blancs étaient venus planter au milieu des nations indiennes ». Aujourd’hui la ville compte plus de 60.000 habitants et se trouve dotée d’un petit aéroport.
Rédigé sur le steamboat qui le ramène vers le monde civilisé, à partir de notes prises quotidiennement, ‘Quinze jours au désert’ relate ainsi ce périple qu’Alexis de Tocqueville a effectué du 18 au 29 juillet 1831 avec son ami et collègue Gustave de Beaumont, dans se qui constitue aujourd’hui l’Etat du Michigan, alors encore en grande partie sauvage.
En voici quelques bribes.
Et en introduction de ce voyage, peu avant de prendre un vapeur pour Détroit, les réflexions inspirées par la rencontre, au sortir de Buffalo, d’un jeune indien ivre mort, couché sur le bord de la route et que personne ne daigne secourir : « Qu’est-ce que la vie d’un Indien ? C’était là le fond du sentiment général. Au milieu de cette société si jalouse de moralité et de philanthropie, on rencontre une insensibilité complète, une sorte d’égoïsme froid et implacable… ». Voici saisi le cœur des habitants des Etats-Unis ; un cœur habité ce même «instinct impitoyable qui anime ici comme partout ailleurs la race européenne ». D’ailleurs, constate Tocqueville, « combien de fois, dans le cours de nos voyages, n’avons-nous pas rencontré d’honnêtes citadins qui nous disaient le soir, tranquillement assis au coin de leur foyer : Chaque jour le nombre des Indiens va décroissant ! Ce n’est pas cependant que nous leur fassions souvent la guerre, mais l’eau-de-vie que nous leur vendons à bas prix en enlève tous les ans plus que ne pourraient faire nos armes. Ce monde-ci nous appartient, ajoutaient-ils ; Dieu en refusant à ses premiers habitants la faculté de se civiliser, les a destinés par avance à une destruction inévitable. Les véritables propriétaires de ce continent sont ceux qui savent tirer parti de ses richesses ».
Et en introduction de ce voyage, peu avant de prendre un vapeur pour Détroit, les réflexions inspirées par la rencontre, au sortir de Buffalo, d’un jeune indien ivre mort, couché sur le bord de la route et que personne ne daigne secourir : « Qu’est-ce que la vie d’un Indien ? C’était là le fond du sentiment général. Au milieu de cette société si jalouse de moralité et de philanthropie, on rencontre une insensibilité complète, une sorte d’égoïsme froid et implacable… ». Voici saisi le cœur des habitants des Etats-Unis ; un cœur habité ce même «instinct impitoyable qui anime ici comme partout ailleurs la race européenne ». D’ailleurs, constate Tocqueville, « combien de fois, dans le cours de nos voyages, n’avons-nous pas rencontré d’honnêtes citadins qui nous disaient le soir, tranquillement assis au coin de leur foyer : Chaque jour le nombre des Indiens va décroissant ! Ce n’est pas cependant que nous leur fassions souvent la guerre, mais l’eau-de-vie que nous leur vendons à bas prix en enlève tous les ans plus que ne pourraient faire nos armes. Ce monde-ci nous appartient, ajoutaient-ils ; Dieu en refusant à ses premiers habitants la faculté de se civiliser, les a destinés par avance à une destruction inévitable. Les véritables propriétaires de ce continent sont ceux qui savent tirer parti de ses richesses ».
A Détroit, cette ville fondée en 1710 aux bornes de la civilisation par des jésuites, nos aventuriers ne savent où se diriger ; et devront y mentir sur leurs intentions : car si l’Américain admet fort bien qu’on puisse « traverser des forêts presque impénétrables, passer des rivières profondes, braver des marais pestilentiels, dormir dans les bois » pour gagner un dollar, « qu’on fasse de pareilles courses par curiosité, c’est ce qui n’arrive pas jusqu’à son intelligence ».
Il leur faudra une journée à cheval depuis Détroit pour atteindre Pontiac, peu après le coucher du soleil. « Vingt maisons très propres et fort jolies, formant autant de boutiques bien garnies, un ruisseau transparent, une éclaircie d’un quart de lieue carré, et alentour une forêt sans borne : voilà le tableau fidèle de Pontiac qui, dans vingt ans peu être, pressent Tocqueville, sera une ville ». Désormais la cité est considérée comme une banlieue de Détroit et abrite un stade de plus de 80.000 places.
 |
| Alexis de Tocqueville |
La ‘Log house’ de l’émigrant est « en général placée au centre d’un terrain plus soigneusement cultivé que le reste, mais où cependant l’homme soutient encore une lutte inégale contre la nature ». (…) « Ses murs, ainsi que son toit, sont formés de troncs d’arbres non équarris, entre lesquels on a placé de la mousse et de la terre pour empêcher le froid et la pluie de pénétrer dans l’intérieur de la maison. (…) Il n’y en général à cette cabane qu’une seule fenêtre ». Quant au pionnier lui-même, concentré dans le seul but est de faire fortune, il a fini « par se créer une existence toute individuelle ; les sentiments de famille sont venus se fondre eux-mêmes dans un vaste égoïsme, et il est douteux que dans sa femme et ses enfants il voie autre chose qu’une portion détachée de lui-même ». Mais on croise aussi dans les vastes étendues solitaires, parfois de ces Européens « qui, en dépit des habitudes de leur jeunesse, on fini par trouver dans la liberté du désert un charme inexprimable (…) et préfèrent à leurs compatriotes les Indiens dans lesquels cependant ils ne reconnaissent pas des égaux ».
En route : « De temps en temps, un petit lac apparaît comme une nappe d’argent sous le feuillage de la forêt. Il est difficile de se figurer le charme qui environne ces jolis lieux où l’homme n’a point fixé sa demeure, et où règne encore une paix profonde et un silence non interrompu ». (…) « C’est une admiration tranquille, une émotion douce et mélancolique, un dégoût vague de la vie civilisée, une sorte d’instinct sauvage qui fait penser avec douleur que bientôt cette délicieuse solitude aura cessé d’exister. Déjà, en effet, la race blanche s’avance à travers les bois qui l’entourent, et dans peu d’années l’Européen aura coupé les arbres qui se réfléchissent dans les eaux limpides du lac et forcé les animaux qui peuplent ses rives de se retirer vers de nous déserts ».
« Quel diable de pays est ceci, dis-je, où l’on a des ours pour chien de garde ». Ils venaient d’arriver, morts de fatigue, en pleine nuit à Flint-River, au devant d’une Log house isolée, avec pour les accueillir un ours noir tirant méchamment sur sa chaîne. Le lendemain, 25 juillet, nos aventuriers prendront deux guides, des indiens Chippeways. C’est qu’« un désert de 15 lieues sépare Flint-River de Saginaw, et le chemin qui y conduit est un sentier étroit, à peine reconnaissable à l’œil ».
« L’homme civilisé marchait en aveugle, reconnaîtra Tocqueville, incapable non seulement de se guider dans ce labyrinthe qu’il parcourait, mais même d’y trouver les moyens de soutenir sa vie ». C’est la rencontre avec la nature. Et de se perdre en un lieu là où « s’élevait d’un seul jet une haute futaie composée presque en totalité de pins et de chênes. Obligé de croître sur un terrain très circonscrits et privé des rayons du soleil, chacun de ses arbres monte rapidement pour chercher l’air et la lumière. (…) C’est selement quand il est parvenu à une région supérieure, qu’il étend tranquillement ses branches et s’enveloppe de leur ombre. (…) Au-dessous de cette voûte humide et immobile l’aspect change et prend un caractère nouveau. Un ordre majestueux règne au-dessus de votre tête. Près du sol, au contraire, tout offre l’image de la confusion et du chaos : des troncs incapables de supporter plus longtemps leurs branches se sont fendus dans la moitié de leur hauteur et ne présentent plus à l’œil qu’un sommet aigu et déchiré. D’autres, longtemps ébranlés par le vent, ont été précipités d’une seule pièce à terre… ». C’est avec un pincement au cœur, habité d’un sentiment contradictoire que le voyageur d’occident constate : « Il n’y a pas parmi nous de pays si peuplé, où une forêt soit assez abandonnée à elle-même pour que les arbres, après y avoir suivi tranquillement leur carrière, y tombent enfin de décrépitude. C’est l’homme qui les frappe dans la force de leur âge et qui débarrasse la forêt de leurs débris ».
 |
| Vue de South-Bay village sur le bord du lac Onéida (près de l'île du français), le 8 juillet 1831, dessin de Gustave de Beaumon |
« … Mais il est temps de revenir à la route de Saginaw ». La nuit et son humidité glaciale venues, il leur faudra encore un bon moment avant de sortir du bois pour butter enfin sur une rivière. Et leurs guides de pousser « trois fois le cri sauvage qui retentit comme les notes discordantes d’un Tam-tam ». Puis un canot Indien, avec à son bord un homme accroupi portant le costume et ayant l’allure d’un Indien. C’était un bois-brûlé, soit le fils d’un Canadien et d’une Indienne, s’exprimant parfaitement en français.
Derniers instants de grâce : le voyageur installé dans le canot avec son cheval nageant dans le sillage de l’embarcation, tandis que le Canadien rame en silence sous la lune : « il y avait dans l’ensemble de ce spectacle une grandeur sauvage qui fit alors et qui a laissé depuis une impression profonde dans notre âme ».
A Saginaw, à peine arrivé qu’il faut songer à repartir. Mais le but n’était que prétexte au voyage ; avec cette leçon de sagesse donnée par l’indigène du Nouveau Monde qui « jette de temps en temps un regards stoïque sur les habitations de ses frères d’Europe. N’allez pas croire qu’il admire leurs travaux ou envie leur sort (…) Il sourit amèrement en nous voyant tourmenter notre vie pour acquérir des richesses inutiles. Ce que nous appelons industries, il l’appelle sujétion honteuse ».
Et le retour vers cette civilisation, fierté de l’occidental, dont la marche va irrémédiablement écraser la grandeur naturelle et sauvage, ne pourra laisser au jeune Tocqueville, en ce jour de son 27ieme anniversaire, que « l’âme agitée par des idées et des sentiments contraires ».
Qu’il me soit permis enfin de dire un mot de cette édition de ‘Quinze jours au désert’ réalisée par ‘le passager clandestin’. Les amoureux des livres le savent bien ; l’objet en lui-même, sa mise en page, sa texture, son odeur, ou encore l’illustration de sa couverture, sont autant d’éléments qui contribuent à en signer la singularité. Il en ressort un climat, un plaisir pour les sens tout particulier. A ce titre, cette édition recèle le charme discret de ces petits trésors de notre enfance ; tels ces cailloux colorés ou encore ces coquillages trouvés sur les rivages de nos épopées juvéniles, et que l’on conserve précieusement par devers soi malgré l’âge mûr… ‘Quinze jours au désert’ est un très bel objet, dont l’esprit s’accorde à merveille à ce périple au désert. La ‘log house’ me fait irrémédiablement songer àWalden ; à l’étang de Thoreau… Un livre, à la couverture légèrement gaufrée, qu’il est bon d’avoir entre les mains…
Je n’oublie pas cette très belle préface de Claude Corbo. L’essentiel y est dit avec les mots qu’il convenait d’associer ensembles. Et si je n’ai pas évoqué ici cette ‘Course au lac Oneida’, c’est uniquement pour entretenir « l’étrange pouvoir de l’imagination sur l’esprit de l’homme », et susciter l’envie d’aller se perdre en ce texte à la beauté nimbée de nostalgie.
Je n’oublie pas cette très belle préface de Claude Corbo. L’essentiel y est dit avec les mots qu’il convenait d’associer ensembles. Et si je n’ai pas évoqué ici cette ‘Course au lac Oneida’, c’est uniquement pour entretenir « l’étrange pouvoir de l’imagination sur l’esprit de l’homme », et susciter l’envie d’aller se perdre en ce texte à la beauté nimbée de nostalgie.


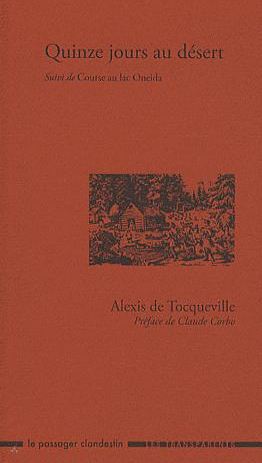

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire