« Tandis que sans hésiter mes connaissances entraient dans le commerce ou embrassaient les professions, je tins cette occupation (la cueillette des myrtilles) pour valoir tout au moins la leur… (…) Certains se montrent « industrieux », et paraissent aimer le labeur pour lui-même, ou peut-être parce qu’il les préserve de faire pis ; à ceux-là je n’ai présentement rien à dire ». ( p 84) Les choses sont ainsi claires. Et à ces derniers, égarés sans doute par le plus grand des hasards en ces sous-bois de Walden, il serait sain, si tant est qu’ils redoutent secrètement que ne leur tombe les écailles des yeux, de suivre le sage conseil de s’en tenir là ; et de s’en retourner prestement vaquer à de plus utilitaires occupations… Mais si d’aventure, par de propices velléités oisives, surgies d’on on ne sait quel bas-fond de l’âme, d’aucuns parmi ces handicapés de l’Otium s’en arrivaient à se perdre avec cet étrange sentiment de délectation paisible qui caractérise si bien les navigateurs des étendues solitaires, nous n’aurions point tout à fait perdu !
Ainsi, est-ce à une ballade dans les méandres de quelques citations sorties de cette fameuse Vie dans les bois, commise il y a de cela un peu plus d’un siècle et demi par un certain Henry David Thoreau, que je convie le voyageur peu pressé à se fondre dans le fracas frénétique de nos existences métronomes, engluées qu’elle sont dans le routinier chaos de ces temps dits « post-modernes ». Il y a certes là un paradoxe, un oxymore qu’il ne m’appartient pas de lever ici. Et s’il se trouve toujours de arbitraire à picorer ainsi dans l’œuvre d’un grand ancien, qu’on se le dise, notre explorateur, s’il embrasse, par exemple, « les opinions de Xenophon et de Platon, par son propre discours, ce ne seront plus les leurs, ce seront les siennes. (…) Et qu’il oublie hardiment s’il veut, d’où il les tient, mais qu’il se les sache approprier. (…) Les abeilles pillotent deçà delà les fleurs, mais elles en font après le miel, qui est tout leur ; ». Tournure d’esprit qu’approuvait manifestement l'auteur de la désoébissance civile. En témoigne cette saillie : « Qu’est-ce que les classiques sinon les plus nobles pensées enregistrées de l’homme ? Ce sont les seuls oracles que n’ait point atteints la décrépitude, et quelque moderne que soit la question posée, elle trouvera en eux des réponses telles que jamais n’en fournirent Delphes ni Dodone » (p 119)
Mais assez de digressions, et allons sans plus tergiverser davantage à notre premier détour.
Thoreau fut-il l’un de ces Cassandre annonciateur de catastrophes en devenir ? A-t-il sourdement pressenti que si opiniâtres cohortes fourmis, Prométhéennes poussières exclusivement occupées à tirer du ventre de la terre de quoi s’aliéner, allaient conduire à l’imparable émasculation du monde ? Bref, est-il, de quelque façon que ce soit, l’un des père des actuelles générations d’objecteurs de croissance ? L’un de ces énergumènes irritant tout aussi bien les aimables progressistes que les nécrophages des institutions financières, ou encore ces capitaines d’industries en haut-de-forme et charbonneux complets ? Si la lucidité en la matière de Thoreau, ce « voyageur immobile » apparaît prémonitoire, et si encore ses introspections lui font voir si nettement au dehors, mieux et plus loin que le commun, gardons-nous cependant de toute tentation à donner dans l’illusion rétrospective. Quoi qu’il en soit, le philosophe de Concord fut indéniablement adepte de la sobriété heureuse. Pour preuve, voici livrées en pâture quelques grandes matières à méditer :
« A l’état sauvage toute famille possède un abri valant les meilleurs, et suffisant (…) il est évident que si le sauvage possède en propre son abri, c’est à cause du peu qu’il coûte, tandis que si l’homme civilisé loue en général le sien, c’est parce qu’il n’a pas les moyens de le posséder ; (…) Une maison moyenne dans ce voisinage (…coûtera en moyenne) de dix à quinze années de la vie du travailleur, même s’il n’est pas chargé de famille – si certains reçoivent plus, d’autres reçoivent moins – de sorte qu’en général il lui aura fallu passer plus de la moitié de sa vie avant d’avoir gagné son wigwam ». (p 39 – 41)
« Le luxe en général, et beaucoup du soi-disant bien être, non seulement ne sont pas indispensables, mais sont un obstacle positif à l’ascension de l’espèce humaine » (p 22)
« Comme s’il fallait (…) se plaindre de la dureté des temps parce que vos moyens ne vous permettent pas de vous acheter une couronne ! (…) Travaillons-nous toujours pour nous procurer davantage, et non parfois à nous contenter de moins ? » (p 46)
Autre sente en ces bois ; cette charge contre le salariat, l’héritage et toutes les formes de servitudes volontairement consenties. Thoreau s’y avère être un dépeceur sans concession :
« Pour les pyramides (…) qu’on ait pu trouver tant d’hommes assez avilis pour passer leur vie à la construction d’une tombe destinée à quelques imbéciles ambitieux, qu’il eût été plus sage et plus mâle de noyer dans le Nil (…) je pourrais peut-être inventer quelque excuse en leur faveur (…) mais je n’en ai pas le temps ». (p 70)
« … grâce au seul labeur de mes mains, je m’aperçus qu’en travaillant 6 semaines environ par an, je pouvais faire face à toutes les dépenses de la vie. La totalité de mes hivers comme la plus grande partie de mes étés, je les eus libres et francs pour l’étude ». (p 83)
« Je vois des jeunes gens, mes concitoyens, dont c’est le malheur d’avoir hérité de fermes, maisons, granges, bétail, et matériel agricole ; attendu qu’on acquiert ces choses plus facilement qu’on ne s’en débarrasse. Mieux eût valu pour eux naître en plein herbage et se trouver allaités par une louve, afin d’embrasser d’un œil plus clair le champ dans lequel ils étaient appeler à travailler » (p 11)
« … grâce au seul labeur de mes mains, je m’aperçus qu’en travaillant 6 semaines environ par an, je pouvais faire face à toutes les dépenses de la vie. La totalité de mes hivers comme la plus grande partie de mes étés, je les eus libres et francs pour l’étude ». (p 83)
« Je n’ai jamais, au cours de mes promenades, rencontré un seul homme livré à l’occupation si simple et si naturelle qui consiste à construire sa maison. Nous dépendons de la communauté ». (p 57)
En cette dernière citation on reconnaît une des pistes de réflexion qu’exploitera André Gorz. A
savoir que l’on passe un temps certain de notre activité salariée pour payer des services (ménage, jardinage, nourrice, aide aux devoir scolaires des enfants, etc.) que l’on pourrait sans doute mieux faire soi-même. Ainsi notre société est organisée de telle sorte que tout ce qui ne relève pas de la logique du Marché se trouve entravé, voire interdit. Tel est par exemple l’un des motifs, au nom d’un hygiénisme fort commode, de la disparition des apothicaires et autres bouilleurs de cru. Et il est en la matière des tentations qui incitent à vigilance ; ainsi l’affaire du purin d’ortie, ou demain la remise en question des jardins potagers ou basses-cours paysannes, pour cause de risques infectieux. On mesure tout le cynisme de telles démangeaisons lorsque qu’on sait que les pandémies en ce domaine viennent par priorité de l’élevage industriel. La logique est toujours de faire dépendre chacun de la communauté marchande. A ce titre, l’oubli des pratiques les plus simples, comme celui de se faire sa propre cuisine, se révèle à terme des plus efficace. Mais assez de ce plat et changeons de rivage.
Pour ce faire, embarqués sur un frêle esquif, laissons nous porter par le hasard de la brise sur les eaux translucides de l’étang ; et y rester sans but à flâner des heures au soleil, tandis que nos besogneuses résolutions se dissolvent dans les nuages :
« J’ai passé bien des heures, alors que j’étais plus jeune, à flotter à sa surface au gré du Zéphyr, après avoir pagayé jusqu’au centre, étendu sur le dos en travers des bancs du bateau, par quelque après-midi d’été, rêvant les yeux ouverts, jusqu’à ce que le bateau touchant le sable, cela me réveillât, et je me redressais pour voir sur quel rivage mes destins m’avaient poussés – jours où la paresse était la plus attrayante, la plus productive industrie. Mainte matinée me suis-je échappé, préférant employer ainsi la plus estimée partie du jour ; car j’étais riche, sinon d’argent, du moins d’heures ensoleillées comme de jours d’été, et les dépensais sans compter ; ni regretté-je de ne pas en avoir gaspillé davantage dans l’atelier ou dans la chaire du professeur (…). Maintenant c’en est fini des troncs d’arbres du fond, de la vieille pirogue en bille de pin, des sombres bois environnants, et les gens du village, qui savent à peine où il est situé, au lieu d’aller à l’étang se baigner et boire, songent à en amener l’eau, qui devrait être pour le moins aussi sacrée que celle du Gange, jusqu’au village par un tuyau, pour s’en servir à laver la vaisselle ! » (p 221 – 222)
Ce côté du rivage montre de nouveaux aspects. Des pierres et du sable. Des oiseaux. De l’eau toujours ! Et cette causerie imaginaire, atemporelle, qui tourne ses humeurs en direction de l’institution scolaire, de la philosophie, de la culture de soi et autres domaines de l’esprit :
« Etre philosophe ne consiste pas simplement à avoir de subtiles pensées, ni même à fonder une école, mais à chérir assez la sagesse pour mener une vie conforme à ses préceptes, une vie de simplicité, d’indépendance, de magnanimité, et de confiance » (p 22)
« J’entend qu’ils (les étudiants) devraient ne pas jouer à la vie, ou se contenter de l’étudier, mais la vivre pour de bon du commencement à la fin ». ( p 63)
« … en général on s’inquiète plus d’avoir des vêtements à la mode, ou tout le moins bien faits et sans pièces, que d’avoir une conscience solide » (p 30)
Croquer la vie à plein… Et oui la simplicité ! De la simplicité, de la simplicité encore…
« Ce qu’il me fallait, c’était de vivre abondamment, sucer toute la moelle de la vie, vivre assez résolument, assez en Spartiate, pour mettre en déroute tout ce qui n’était pas la vie… Notre vie se gaspille en détails. (…) De la simplicité, de la simplicité, de la simplicité ! Oui, que vos affaires soient comme deux ou trois, et non cent ou mille… » (p 107)
Sans oublier l’importance de la lecture :
« Que d’hommes ont fait dater de la lecture d’un livre une ère nouvelle dans leur vie ! » (p 127)
Et qu’on ne s’y trompe point, il s’agit là d’une solitude choisie :
« Je trouve salutaire d’être seul la plus grande partie du temps. Etre en compagnie, fût-ce avec la meilleure, est vite fastidieux et dissipant. J’aime à être seul. Je n’ai jamais trouvé de compagnon aussi compagnon que la solitude. Nous sommes en général plus isolés lorsque nous sortons pour nous mêler aux autres hommes que lorsque nous restons au fond de nos appartements (…) Le fermier peut travailler seul tout le jour dans le champ ou les bois, à sarcler ou à fendre, parce qu’il est occupé, mais lorsqu’il rentre le soir au logis, incapable de rester assis seul dans une pièce, à la merci de ses pensées, il lui faut être là où il peut « voir les gens », et se recréer, selon lui se récompenser de sa journée de solitude ; de là s’étonne-t-il que l’homme d’études puisse passer seul à la maison toute la nuit et la plus grande partie du jour, sans ennui, ni « papillons noirs » ». (p 158 – 159)
En cet isolement, rien de triste ni de sinistre car, « Il ne peut être de mélancolie tout à fait noire pour qui vit au milieu de la Nature et possède encore ses sens. (…) Pendant que je savoure l’amitié des saisons j’ai conscience que rien ne peut faire de la vie un fardeau pour moi » (p 153).
Mais en cet éternel présent tout passe…
Alors, à l’appel du soir, tandis que les bêtes diurnes courent au gîte au moment même où celles de minuit s’ébrouent gaiement sous la lune naissante, prenons, avant de rentrer au logis, le temps d’une dernière leçon. Celle que retint sans doute Ivan Illich. Car on décèle ici l’origine de son concept de « vitesse généralisée », et du calcul du « rapport de la distance parcourue au temps que l’on met à la parcourir ». Idée qui sera réactualisée avec succès par Jean-Pierre Dupuy. Ce dernier réitérera l’opération sur l’automobile. Et même s’il y a controverse sur les chiffres, cela ne remet en rien en cause la logique du raisonnement, ni ses conséquences :
« Vous pourriez prendre le chemin de fer, et aller à Fitchurg aujourd’hui pour voir le pays. Mais je suis plus sage. J’ai appris que le voyageur le plus prompt est celui qui va à pied. Je répond à l’ami : « Supposez que nous essayions de voir qui arrivera le premier. La distance est de 30 miles ; le prix du billet, de 90 cents. C’est là presque le salaire d’une journée. (…) Soit, me voici parti à pied, et j’atteins le but avant la nuit. J’ai voyagé de cette façon des semaines entières. Vous aurez pendant ce temps-là travaillé à gagner le prix de votre billet, et arriverez là-bas à une heure quelconque demain… » (p 65)
Une fois le manteau d’ombre tombé, tournant l’oreille sur les stridulations des insectes nocturnes, conservons enfin, alors que nos regards se portent sur la brume agitée sous nos pas, une pensée envers ces gens qui veulent notre bien, ou ceux qui se font vocation de soulager la misère d’autrui :
« Si je tenais pour certain qu’un homme soit venu chez moi dans le dessein bien entendu de me faire du bien, je chercherais mon salut dans la fuite (…) de peur de voir une parcelle de son virus mélangé à mon sens ». (p 88-89)
« Il en est mille pour massacrer les branches du mal contre un qui frappe à la racine, et il se peut que celui qui consacre la plus large somme de temps et d’argent aux nécessiteux contribue le plus par sa manière de vivre à produire cette misère qu’il tâche en vain de soulager ». (p 90)
Cette dernière phrase est lisible de différentes manières. D’aucuns pourraient y reconnaître une forme larvée de darwinisme social, ou l’on conseille de point porter assistance aux plus démunis. Plus sûrement s’agit-il d’une mise en garde de bon sens : la meilleure volonté ne suffit point à faire la bonne conscience. Et la manière d’acquiescer à un type de société, que l’on ne ronge au fond qu’à la marge, contribue insidieusement à entretenir les maux qui nous donnent par ailleurs la nausée.
Mais il se fait tard. Tout est silence désormais… Mais ce n’est que le délicieux silence des organes décrit par Epicure. La nature quant à elle bruisse de toutes ses feuilles… Aussi, emplis d’une paix voluptueuse, nous nous étendons sur le dos dans l’herbe baignée de rosée, et restons là à contempler le ciel picoré d’étoiles ; débordés de sensations vives, avec ce sentiment étrange de dépassement de nos propres limites corporelles… Insignifiants et immenses tout à la fois…
Les yeux se closent et les pensées se mélangent…
« Pour ce qui est de la chasse aux oiseaux, pendant les dernières années que je portai une carabine, j’eus pour excuse que j’étudiais l’ornithologie, et recherchais les seuls oiseaux nouveaux ou rares. Mais j’incline maintenant à penser, je le confesse, qu’il est une plus belle manière que celle-ci d’étudier l’ornithologie (…) Telle est le plus souvent la présentation du jeune homme à la forêt. Il y va d’abord en chasseur ou en pêcheur, jusqu’au jour où, s’il détient les semences d’une vie meilleure, il distingue ses propres fins, comme poète ou naturaliste peut-être, et laisse là le fusil aussi bien que la canne à pêche » (p 243 - 244)
Quelques chasseurs en Baie de Somme sortiraient grandis à s’en inspirer.
Trêve de divagations. Nous ne sommes point de purs esprit, nos sens se manifestent. Et à l’heure des chats-huants, une petite fringale nous étreint enfin… N’avons ni besace ni écuelle. Juste une pomme agrémentée de quelques baies ; et l’eau si pure de l’étang… De quoi se sustenter et parer à l’essentiel.
« Le gros mangeur est un homme à l’état de larve ; et il existe des nations entières dans cette condition, nations sans goût ni imagination, que trahissent leurs vastes abdomens » (p 247)
On se doute de ce que Thoreau penserait à la vue des Etats-Unis d’aujourd’hui, tandis que l’obésité gagne l’Europe… Des territoires qui ne représente qu’un sixième de la population mondiale, mais où l’on dépense plus pour la toilette des animaux de compagnie que pour nourrir l’Afrique entière. Civilisation singulière ou l’on caresse avec amour son chat tandis que l’on massacre, en des usines ultramodernes, des masse considérables de bêtes.
« Je ne doute pas que la race humaine, en son graduel développement, n’ait entre autres destinées celle de renoncer à manger des animaux ». (p 248)
Nous en sommes, hélas bien loin, et ce ne sera que sous la contrainte que nous nous y résoudrons sans doute, une fois le pire advenu.
Mais ne voulant point quitter ces lieux sur de si sinistres présages, évoquons à mots couverts ce film magnifique réalisé par Sean Penn, « Into the wild » ; l’adaptation d’un livre, mais avant tout l’histoire bien réelle de Christopher McCandless, un jeune révolté rejetant les principes de nos sociétés où le factice et le paraître règnent en maître. Lecteur de Tolstoï et de Thoreau, il finira au terme d’une fulgurante odyssée, sa brève existence dans l’épave d’un bus perdu dans les montagnes de l’Alaska.
Poignante leçon de vie.
Et après un hiver passé dans la solitude la plus complète, griffonné à la hâte sur un vieux bouquin à l’ultime moment, ces quelques mots « Happiness only real when shared »
(1) Montaigne, Essais, livre I, chapitre XXV, « De l’institution des enfants ».



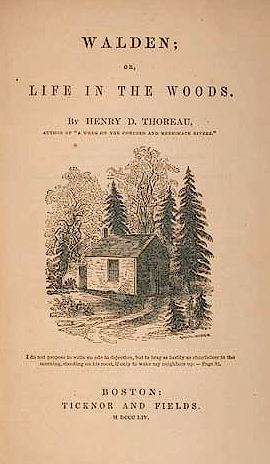





Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire